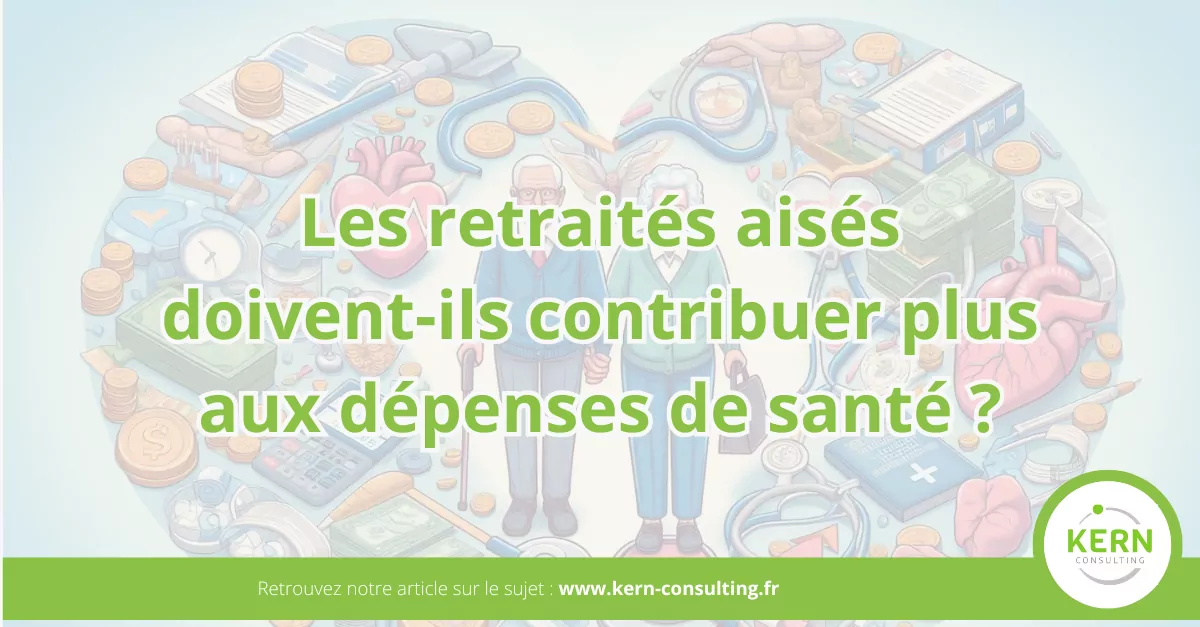L’état des lieux[i] mené par la DREES sur la structure des dépenses de santé des Français, bien que s’appuyant sur des données peu récentes (2019), donne une vision intéressante du poids de ces dépenses en fonction du niveau de vie, de la catégorie socioprofessionnelle et de l’âge. De quoi relancer le débat sur le financement de la protection sociale ?
L’un des principaux résultats est contre-intuitif dans un système basé sur la redistribution et réputé progressif : alors que les « taux d’effort » augmentent en moyenne avec les revenus pour les actifs en emploi, ils diminuent pour les retraités.
En clair, plus un actif en emploi a des revenus élevés, plus le poids de ses contributions aux dépenses de santé – individuelles ou de solidarité – dans ses revenus augmente ; à l’inverse, plus un retraité a un niveau de vie élevé, moins la proportion de ses contributions est élevée.
Le taux d’effort, cumul du reste à charge, des primes d’assurance et des taxes et prélèvements
Ce taux d’effort ne représente pas directement l’utilisation ou la dépense de soins, mais très précisément « la part du revenu consacrée par les ménages à leur santé, que ce soit via les restes à charge, les primes d’assurance ou les taxes et prélèvements finançant l’assurance maladie obligatoire. »
Cette part de revenu affectée à la santé (en moyenne 15% du revenu) est pourtant partiellement corrélée aux dépenses de santé individuelles : si le reste à charge (en moyenne 1% du revenu) est directement affecté à sa propre santé, les taxes et prélèvements finançant le régime obligatoire (en moyenne 11% du revenu) ne le sont pas et relèvent de la solidarité. La situation est moins tranchée pour les primes d’assurance (en moyenne 3% du revenu) : un contrat collectif obligatoire dont le niveau de prime est généralement fixé globalement ne traduit pas la consommation directe de soins de santé, mais les personnes ayant fait le choix plus ou moins contraint d’un contrat individuel peuvent choisir un niveau de couverture – et donc de primes d’assurance – élevé si elles prévoient des besoins de santé importants, comme c’est le cas pour les personnes âgées.
Un taux d’effort supérieur pour les actifs alors qu’ils consomment moins, et même régressif en fonction des revenus au sein des retraités
L’évolution du taux d’effort en fonction du niveau de vie et de la situation socioprofessionnelle est particulièrement intéressante.
Pour les actifs en emploi, le taux d’effort progresse régulièrement de 15 à 18% du revenu selon le niveau de vie (catégories « très modeste », « plutôt modeste », « médian », « plutôt aisé », « très aisé ») ; la part consacrée au financement de l’assurance maladie obligatoire est même encore plus progressive, de 11 à 16% quand on grimpe depuis les catégories les moins aisées vers les plus aisées.
Pour les retraités, c’est l’inverse : le taux d’effort passe de 14% à 11% en montant vers les catégories les plus aisées, indiquant des cotisations qui ne sont pas progressives et deviennent même régressives. La part des taxes et prélèvements est en dents de scie : de 6,32% pour les très modestes, elle baisse à 6,13% pour les plutôt modestes, remonte à 7,19% pour les médians, 8,18% pour les plutôt aisés, pour redescendre à 7,74% pour les très aisés.
Ces différences restent-elles socialement acceptables ?
Les chiffres[ii] de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie sont pourtant édifiants : la consommation moyenne de soins augmente très fortement avec l’âge. Les personnes dans les tranches d’âge 60-74 ans, 75-84 ans et 85 et plus ont une consommation représentant respectivement 2,2 fois, 3,4 fois et 4,5 fois celle de la tranche d’âge 17-59 ans en soins de ville ; et respectivement 2,4 fois, 3,4 fois et 4,8 fois celle en établissements de santé (hospitalisation principalement).
A l’heure où le débat est rouvert sur le financement des déficits pour réduire la dette, force est de constater qu’une partie significative provient des différentes branches de l’assurance maladie – 16 milliards de déficit prévus en 2025 dans la Loi de Financement de la Sécurité Sociale 2025[iii] dont 13,4 pour l’assurance maladie.
Les questions sur ceux qui doivent contribuer plus pour au moins ralentir l’augmentation de la dette se posent avec acuité. Sans remettre en cause le principe de solidarité, ne serait-il pas légitime que les retraités, particulièrement les plus aisés dont le taux d’effort est plus faible que les plus modestes, se voient demander des contributions supérieures pour les soins dont ils seront amenés à bénéficier bien plus que les actifs ?
[i] https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/sites/default/files/2025-08/ER1345-MEL_0.pdf
[ii] https://evaluation.securite-sociale.fr/home/maladie/1.6.3.%20Recours%20aux%20soins%20et%20cons.html
[iii] https://www.securite-sociale.fr/files/live/sites/SSFR/files/medias/PLFSS/2025/PLFSS2025-Annexe03.pdf